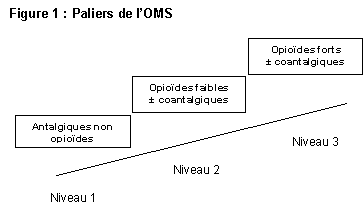|
La douleur
est un symptôme fréquemment associé au cancer, surtout
dans les phases évoluées de la maladie. Son traitement
doit être complémentaire des thérapeutiques spécifiques
du cancer en cause.
Plusieurs classes de médicaments sont à notre disposition,
qui peuvent être utilisées seules ou en association. Il
faut choisir le schéma thérapeutique le plus simple et le
moins invasif possible, après avoir identifié et évalué
les causes spécifiques, l'intensité, et la qualité de la
douleur.
L'OMS, dans ce cadre, a
proposé une stratégie dont les points essentiels sont les
suivants :
* Prescription par voie orale
: facile pour le patient, non invasive, efficace, et la
moins onéreuse.
* Prescription à horaire fixe : en tenant compte de la
durée d'action des produits.
* Prescription en respectant l'échelle de l'OMS à trois
niveaux (figure 1)
* Prescription personnalisée : en fonction de l'âge, des
antécédents, des interférences médicamenteuses.
* Prescription ne négligeant aucun détail : impliquant une
parfaite connaissance du patient et de son dossier.
Le principe dominant
étant que l'inefficacité d'un antalgique commande le
passage à l'échelon supérieur.
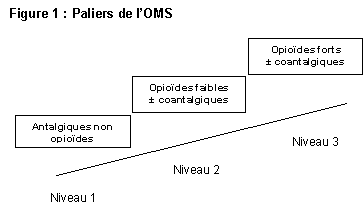
Le principe dominant étant
que l'inefficacité d'un antalgique commande le passage à
l'échelon supérieur.
Le premier niveau de
l'échelle de l'OMS est représenté par le paracétamol et
les AINS pour le traitement des douleurs d'intensité faible
ou modérée.
Lorsqu'à posologie convenable, les médicaments de niveau 1
ne sont plus efficaces, il est nécessaire de passer à la
marche suivante de l'escalier thérapeutique : celle des
opioïdes faibles (niveau 2) ne figurant pas sur la liste
des stupéfiants.
En cas d'échec, sans tarder, on aura recours aux opioïdes
majeurs (niveau 3) dont le chef de file est la morphine.
A chaque niveau de l'échelle antalgique OMS, on peut
associer aux médicaments antalgiques un traitement
co-antalgique médicamenteux ou non.
1) Les analgésiques de
niveau 1 - douleur de faible intensité -
Ce sont essentiellement les
salicylés, le paracétamol, les AINS.
De préférence par voie
orale, pris à intervalle régulier en fonction de leur
durée d'action, et non pas à la demande, à posologie
adaptée à l'état du patient, en tenant compte des
principaux effets secondaires.
- Le paracétamol
Il est préféré à l'aspirine étant donné l'absence
d'effets sur l'agrégation plaquettaire. Mais il a une
toxicité hépatique à forte dose, d'autant qu'il existe
une insuffisance hépatique préalable et/ou une
intoxication éthylique. Son mécanisme d'action est double
: central et périphérique. Sa posologie habituelle, chez
l'adulte, est de 500 mg à 1g, 3 fois/24h.
- Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS)
Ils sont répartis en groupes chimiquement distincts, mais
ont des propriétés communes plus ou moins marquées et
exploitées : antalgique, antipyrétique,
anti-inflammatoire. Leurs effets secondaires varient un peu
d'un AINS à l'autre, mais ils ont globalement le même
profil : effets digestifs plus ou moins marqués, toxicité
médullaire, toxicité hépatique ou rénale.
Les propriétés
pharmacologiques - dues à l'inhibition des prostaglandines
- entraînent des contre-indications.
Certaines associations médicamenteuses sont à éviter :
anti-coagulants, méthotréxate, cisplatine, lithium,
anti-hypertenseurs, diurétiques, dixogine.
Le problème essentiel est la
prévention des lésions gastro-duodénales. Si une
protection est nécessaire, l'oméprazole à la dose de 20
mg par jour est le plus efficace et a l'AMM en France.
L'efficacité des AINS peut être parfois retardée. Il faut
certainement commencer par des doses faibles, et augmenter
progressivement.
2) Les analgésiques de
niveau 2 : les opioïdes faibles
- douleur d'intensité modérée -
- La codéine
Elle est antalgique en partie du fait de sa dégradation en
morphine. Elle s'utilise en France le plus souvent en
association avec le paracétamol (aux doses de 30 à 60 mg
pour 350mg à 1 000 mg de paracétamol), toutes les 4 à 6
heures.
- La dihydrocodéine
Il s'agit d'un analogue semi-synthétique de la codéine. En
France, ce produit est disponible sous forme orale à
libération prolongée (Dicodin 60 LP). Sa posologie est de
60 mg, toutes les 12 heures.
Il est toujours nécessaire de prévenir la constipation,
qui est l'effet secondaire le plus fréquent.
- Le dextropropoxyphène
Bien que moins puissant que la codéine, il est très
utilisé en raison du peu d'effets secondaires qu'il
entraîne. Il existe sous forme pure ou associée au
paracétamol. La dose préconisée est de 60 mg, 3 à 4 fois
par jour.
- On peut utiliser aussi des
produits associant de l'opium - base ou de la morphine au
paracétamol ou à la scopolamine.
- Le tramadol (Topalgic)
Il a un effet opioïde d'une part, et un effet
mono-aminergique d'autre part. Il est utilisé per os à la
dose de 50 à 100 mg, 4 fois par jour. Ses principaux effets
secondaires sont des vertiges, des nausées, une sédation.
3) Les analgésiques de
niveau 3 : les opioïdes forts - douleur sévère -
Les agonistes purs
Ils sont caractérisés par le fait que l'augmentation de la
dose entraîne toujours une augmentation de l'effet
analgésique. Les différences entre les produits de ce
groupe résident essentiellement dans leur rapport
d'équianalgésie (puissance).
- La morphine
Par voie orale, chez l'adulte : Elle doit être prescrite
précocement en cas de douleur résistante aux autres
traitements.
L'administration se fait soit : sous forme de solution ou
d'ampoule de chlorydrate de Morphine, toutes les 4 heures,
soit sous forme de comprimés (Moscontin) ou de gélules
(Skénan) de sulfate de morphine à libération prolongée,
toutes les 12 heures. Les comprimés de Moscontin sont
dosés à 10, 30, 60, 100 mg, 200 mg ; ils doivent être
avalés sans être croqués ni pilés, pour conserver leur
effet retard. Les gélules de Skénan sont présentées aux
même dosages. Elles peuvent, au contraire être ouvertes et
introduites dans une sonde gastrique ou une gastrotomie si
besoin.
Du sulfate de morphine à libération prolongée sur 24
heures vient d'être commercialisé : (Kapanol) sous forme
de gélules dosées à 20, 50, 100 mg (Tableau 1).
Tableau 1 : Présentations
de morphine orale
|
Chlorhydrate
de morphine
|
|
Solution
buvable
Sirop
Ampoules 10 mg
|
Toutes les 4 heures
|
|
Sulfate
de morphine
|
Moscontin
Skénan
Kapanol
|
Comprimés
10, 30, 60,100, 200 mg
Gélules 10, 30, 60,
100, 200 mg
Gélules 20, 50, 100 mg
|
Toutes
les 12 heures Toutes les 12 heures Toutes les 24
heures
|
Haut de page
En pratique la solution buvable de morphine " immédiate " devrait être
utilisée pour commencer le traitement et adapter les doses
en fonction de la situation clinique. Habituellement la
posologie de départ est de 10 mg toutes les 4 heures.
Elle doit être inférieure
chez les personnes âgées,
ou en cas de troubles métaboliques - insuffisance
rénale notamment -.
Le relais est pris avec une
forme LP après cette titration.
Si la douleur persiste, et en tenant compte des effets
secondaires, on augmente la posologie en ajoutant des
interdoses de chlorhydrate de morphine à la demande.
On peut ensuite, si le nombre d'interdoses nécessaires est
important, augmenter d'autant la dose quotidienne de
morphine LP. Si leur nombre est limité, on poursuit ainsi,
notamment en cas de douleur instable.
Il faut savoir que chez 15 % des patients, la morphine LP ne
dure que 8 heures, et qu'il est licite dans ce cas de
prescrire trois prises par 24 heures au lieu de deux.
Il n'y a pas de limite supérieure aux doses de morphine :
on augmente la posologie tant que la douleur n'est pas
soulagée et tant que les effets indésirables peuvent être
contrôlés.
- Les effets indésirables
La constipation est
pratiquement inévitable. Sa prévention, dès le premier
jour de prescription des opioïdes, par des mesures
hygiénodiététiques et des laxatifs, est le meilleur
traitement.
Les nausées et les
vomissements sont fréquents en début de traitement et
disparaissent après quelques jours. On peut les traiter par
le métoclopramide et/ou par l'halopéridol ou le
dropéridol.
La somnolence survient les
premiers jours, puis disparaît en quelques jours. Elle peut
refléter une "dette de sommeil". Si elle
persiste, d'autres causes doivent être envisagées :
organique, insuffisance rénale, potentialisation par des
traitements associés.
Les autres effets secondaires
sont moins fréquents : rétention urinaire, prurit, sueurs,
dysphorie.
La tolérance : chez le
cancéreux, on peut voir une diminution de la durée de
l'effet analgésique pour des doses initialement utilisées,
mais c'est le plus souvent à cause de la progression de la
maladie.
La dépendance physique ne pose pas de problème à
condition d'assurer la continuité de la prescription. Si le
traitement morphinique doit être interrompu, il est
nécessaire de le faire progressivement.
La dépendance psychique est très rare chez le douloureux
chronique.
- Le surdosage
Il est dû, soit à une
erreur de dosage, soit une cause intercurrente :
insuffisance rénale ou autre trouble métabolique,
association médicamenteuse ou association à une autre
méthode antalgique comme la radiothérapie. En effet, la
douleur agirait comme un antagoniste de la dépression
respiratoire.
Tant qu'il persiste une
douleur, il n'y a pas de risque desurdosage. Mais une dose
supérieure à celle qui annule la douleur peut entraîner
une dépression respiratoire, qui imposera l'injection de
naloxone.
- Les contre-indications
- Contre-indications de la voie orale.
- Contre-indications relatives : insuffisance rénale,
insuffisance respiratoire grave.
- Effets secondaires trop importants.
Les autres agonistes
purs
- La péthidine
(Dolosal) n'est utilisée que dans les cas d'intolérance à
la morphine. Ses métabolites sont neuro-toxiques, ce qui
limite son intérêt en administration de longue durée.
- Le dextromoramide (Palfium) a une durée d'action
brève (2 à 3 h) et donc n'a pas beaucoup d'intérêt dans
les douleurs chroniques. Il peut être intéressant lors de
manoeuvres douloureuses : mobilisation, pansement.
- Le fentanyl n'existe pas sous forme orale. Nous y
reviendrons.
Les agonistes partiels
- La buprénorphine
(Temgésic) s'administre par voie sublinguale en glossettes
: 3 à 6/j, toutes les 8 heures.
Elle ne doit pas être associée à la morphine puisqu'elle
en réduit l'efficacité.
Les agonistes
antagonistes
La nalbuphine (Nubain)
est peu utilisée chez l'adulte. En France, elle ne se
présente que sous forme injectable.
Tous ces opioïdes de niveau
3 se prescrivent sur carnet à souches en toutes lettres,
pour une durée réglementée :
- morphine orale : 14 jours ; 28 jours pour les formes LP,
- morphine parentérale : 7 jours ; 28 jours par pompe
continue,
- dextromoramide : 7 jours,
- péthidine : 7 jours,
- fentanyl patch : 28 jours.
4) Les traitements
coantalgiques
Leur utilisation doit être
évoquée à chaque palier de l'échelle de l'OMS dans le
but d'accroître l'efficacité des antalgiques.
Ces traitements sont :
- soit médicamenteux : corticoïdes, antidépresseurs,
antiépileptiques, anesthésiques locaux, biphosphonates,
calcitonine,
- soit des moyens physiques : radiothérapie,
kinésithérapie, physiothérapie, massages drainages,
mobilisation, immobilisation, neurostimulation
transcutanée, acupuncture,
- soit à visée psychologique : psychothérapie, thérapie
cognitive, relaxation, hypnose, bio-feed-back,
musicothérapie, PNL,
- soit des méthodes plus invasives : blocs neurolytiques,
neurochirurgie.
Tous ces moyens ont des
indications précises, selon le mécanisme de la douleur,
selon la pathologie responsable et son évolutivité, selon
l'état général du malade, selon l'impact qu'a la douleur
sur sa vie quotidienne. Ils peuvent être associés ou se
succéder dans l'évolution de la maladie.
L'OMS préconise de
privilégier les traitements par voie orale.
Il est des cas où l'on doit abandonner cette voie :
- Si la voie orale est contre-indiquée : impossibilité de
déglutition, malabsorption digestive, occlusion, nausées,
vomissements non contrôlés, troubles de la conscience.
- Si à posologie antalgique, les effets indésirables sont
insupportables.
Dès lors, on peut proposer :
- Le fentanyl en patch
transdermique (Durogésic) a une durée d'action de 72 h.
Selon leur surface, ces patchs délivrent 25, 50, 75 ou 100
µg/h. Leur pose est facile pour les patients. Les
indications sont principalement le traitement de douleurs
stables.
Il entraîne moins de
troubles digestifs que la morphine LP. L'équilibration du
traitement ainsi que le passage vers une autre voie
d'administration n'est pas toujours simple. La prescription
se fait sur carnet à souches pour 28 jours ; la délivrance
se fait en 2 fois.
- La morphine par voie
sous cutanée, en divisant la dose de morphine orale par
2, soit en injections fractionnées toutes les 4 heures,
soit en perfusion continue, soit en bolus administrés par
le malade lui-même grâce à une pompe préprogrammée par
le médecin (PCA : Auto analgésie Contrôlée par le
Patient).
- La morphine par voie
intraveineuse, en divisant la dose orale par 3 en
perfusion continue et/ou en mode PCA.
Le recours à ces voies est maintenant facilité par la mise
sur le marché de pompes portables performantes et peu
encombrantes. Elles permettent l'administration d'une dose
quotidienne continue, à laquelle le patient ajoute des
bolus, dans la mesure du programme préétabli, lors des
pics douloureux (mouvements, soins). Elles préservent
l'autonomie des patients à domicile.
- La morphine peut être
administrée par voie centrale (par des équipes
spécialisées) :
- par voie péridurale ou intrathécale par l'intermédiaire
d'un cathéter laissé en place relié à une pompe portable
réglée en mode continue et/ ou PCA. Les doses de morphine
utilisées sont minimes (10 et 100 fois moindres que per
os),
- par voie intracérébroventriculaire plus rarement dans
les douleurs irréductibles des cancers de la sphère
orofaciale.
CHEZ L'ENFANT
Les règles de prescription
selon la classification de l'OMS sont identiques à celles
énoncées plus haut pour l'adulte.
Quelques particularités expliquent les difficultés
rencontrées en pédiatrie :
- L'évaluation de la douleur chez l'enfant n'est pas
facile, surtout avant cinq ans.
- L'efficacité des molécules analgésiques est mal connue
chez l'enfant.
- Nous disposons de moins de molécules pour traiter la
douleur de l'enfant.
- Les gestes diagnostiques ou thérapeutiques sont source de
douleur et d'anxiété.
La prise en charge ultérieure sera d'autant plus difficile
que l'enfant n'a pas confiance en l'équipe soignante.
Comme chez l'adulte, le choix
de l'analgésique dépend de l'intensité de la douleur, la
prescription est individuelle, à horaire fixe, par voie
orale si possible, en tenant compte des effets secondaires.
A chaque niveau, des médicaments potentialisant l'effet des
antalgiques peuvent être associés.
Les analgésiques de
niveau 1
- Le paracétamol
Bien toléré, maniable, c'est l'antalgique de première
intention. Par voie orale, il est préconisé une dose de 20
à 30 mg/kg.
- L'aspirine et les AINS
ont les même indications et effets secondaires que chez
l'adulte. Les doses d'aspirine préconisées sont de 25 à
50 mg/kg en 2 à 4 prises. L'acide niflumique (Nifluril)
peut être prescrit au nourrisson à partir de 6 mois à 40
mg/kg/j. Le diclofénac (Voltarène), à 2-3 mg/kg/j,
s'utilise pour les enfants de plus de 17 kg et de plus d'un
an.
Les analgésiques de
niveau 2
- La codéine
Depuis le moins de juillet 1998, un sirop de phosphate de
codéine (Codenfan) a l'AMM dès l'âge d'un an. Il est
préconisé à des doses de 0,5 à 1 mg, soit 1 ml/kg, 4
fois par jour.
- Le dextroproxyphène
Il est préconisé par certains auteurs chez le grand enfant
bien que ce produit n'ait pas l'AMM en dessous de 15 ans.
Les analgésiques de
niveau 3
- La morphine par voie
orale
Le soluté buvable de chlorhydrate de morphine, à action
immédiate, est utilisé chez les enfants à partir d'un
mois. Il s'agit d'une préparation magistrale à prescrire
sur carnet à souches pour une durée maximale de 14 jours.
La dilution peut varier pour réduire le volume des prises.
La dose de début est de 1 mg/kg/jour, mais elle doit être
augmentée si la douleur n'est pas calmée et que les effets
indésirables sont maîtrisables.
-
La morphine retard LP s'adresse aux enfants de plus
de 20 kg puisque la dose unitaire la plus petite est de 10
mg pour 12 heures, soit 20 mg par jour.
- La morphine par voie
parentérale et par voie centrale se fait également
chez l'enfant si la voie orale est contre-indiquée.
Enfin, on doit traiter
préventivement la douleur due à certains soins : Par des
antalgiques et/ou par des anxiolytiques, en généralisant
l'utilisation d'EMLA pour les ponctions transcutanées, en
pratiquant davantage d'anesthésies locale, loco-régionale
ou par inhalation (Entonox).
En conclusion
Le schéma thérapeutique
proposé par l'OMS dans le cadre des douleurs du cancer,
reste actuellement un guide de référence, mais on peut
l'extrapoler à d'autres douleurs, comme échelle de
prescription en fonction de l'intensité douloureuse.
Quelque soit l'âge du patient, l'adaptation des posologies
doit se baser sur une évaluation de la douleur, simple mais
rigoureuse, et répétée tout au long de l'évolution de la
maladie.
Références
·
Traitement de la douleur cancéreuse et soins palliatifs. Rapport d'un
comité d'experts de l'OMS. Genève 1990.
|